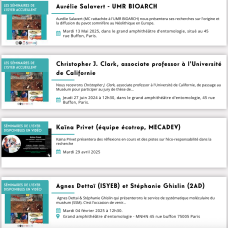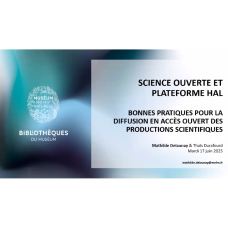Benoît Perez-Lamarque ENS / ISYEB

ISYEB

ISYEB
Benoît Perez-Lamarque, jeune docteur ayant effectué ses recherches à l’Institut de Biologie de l’ENS et à l’ISYEB, et désormais post-doctorant dans ces mêmes instituts,
nous présentera ces travaux.